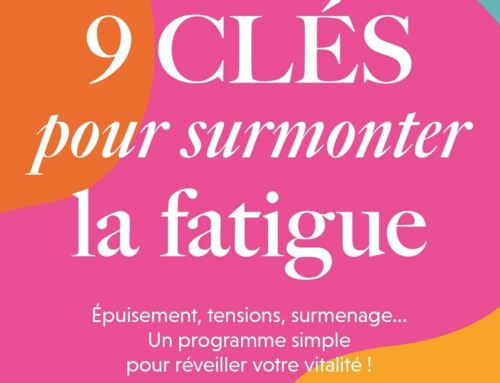Le réveil nocturne touche une personne sur trois. Beaucoup s’en inquiètent, pensant souffrir d’un trouble du sommeil. Pourtant, ce phénomène est loin d’être anormal.
Le réveil nocturne touche une personne sur trois. Beaucoup s’en inquiètent, pensant souffrir d’un trouble du sommeil. Pourtant, ce phénomène est loin d’être anormal.
Pendant des siècles, nos ancêtres dormaient en deux temps : un premier sommeil et un second sommeil (Ekirch, 2005). Ce rythme biphasique, observé du Moyen Âge jusqu’à la révolution industrielle, faisait partie de la vie ordinaire.
Aujourd’hui, notre société obsédée par la performance a érigé le sommeil “d’un seul bloc” en norme. Cette illusion de perfection pousse beaucoup à s’angoisser dès qu’ils se réveillent la nuit.
Mais notre corps, lui, se souvient. Il conserve la mémoire de ce rythme ancien.
Découvrons ensemble comment cette habitude a disparu, pourquoi nos réveils nocturnes persistent et comment renouer avec un sommeil plus naturel, en accord avec soi.
Quand le réveil nocturne était la norme
Avant l’électricité, la nuit gouvernait la vie humaine. Les gens se couchaient peu après le coucher du soleil, puis se réveillaient quelques heures plus tard.
L’historien Roger Ekirch (At Day’s Close – Night in Times Past, 2005) a révélé l’existence de ce sommeil biphasique : deux périodes de sommeil séparées par une veille paisible.
Durant cette parenthèse, on priait, on lisait ou on échangeait calmement. Certains profitaient même de ce moment pour méditer ou observer les étoiles.
Des traces de ce rythme apparaissent dans la littérature, les journaux intimes et les traités médicaux du XVIIᵉ siècle. Ce que nous appelons aujourd’hui insomnie était alors une respiration naturelle du sommeil.
Quand la modernité a imposé le “sommeil parfait”
Avec le XIXᵉ siècle, tout change. La lumière artificielle rallonge les soirées. Les usines imposent des horaires fixes. Le sommeil devient un indicateur de bonne santé et surtout de productivité.
Les médecins commencent à parler d’un “sommeil continu” comme idéal universel. Pourtant, les recherches récentes de l’INSERM (Sommeil et rythmes circadiens, 2023) et du CNRS (Dautzenberg, 2021) montrent que nos rythmes circadiens varient d’une personne à l’autre.
La société moderne, en cherchant à uniformiser nos nuits, a créé de nouvelles angoisses. Désormais, se réveiller la nuit n’est plus vu comme naturel, mais comme un échec. Ainsi, la normalisation du sommeil a fabriqué des insomnies culturelles.
Le réveil nocturne : un mécanisme biologique oublié
Notre horloge interne n’obéit pas toujours à la logique sociale. La mélatonine, hormone clé du sommeil, atteint un pic puis redescend quelques heures plus tard, provoquant un réveil spontané (INSERM, 2023).
Ce phénomène, observé par le neuroscientifique Till Roenneberg (2012), n’est pas pathologique : il reflète une variabilité biologique. Nos chronotypes — “lève-tôt” ou “couche-tard” — influencent aussi ce moment d’éveil.
De plus, le stress, la lumière bleue ou une température inadaptée peuvent amplifier ce cycle naturel. Autrement dit, le réveil nocturne n’est pas un bug de notre cerveau : c’est une trace de notre évolution.
Quand la norme devient source d’angoisse
Parce qu’on nous répète qu’un bon sommeil doit être ininterrompu, chaque réveil devient une alerte. La peur de ne pas se rendormir active le stress et entretient la vigilance. Selon la psychologue Allison Harvey (Oxford University, 2020), vouloir “trop bien dormir” crée une anxiété de performance du sommeil.
Cette tension mentale empêche la relaxation nécessaire à l’endormissement. Beaucoup finissent ainsi piégés dans un cercle vicieux : plus ils veulent dormir, moins ils y parviennent. Le problème ne vient donc pas du corps, mais du jugement qu’on porte sur lui.
Finalement, ce n’est pas le réveil qui fatigue, c’est la peur du réveil.
Réveil nocturne et rythme naturel
Reconnaître que son sommeil peut être fractionné, c’est déjà se libérer.
Certains profitent de ce moment d’éveil pour lire quelques pages, respirer calmement ou simplement observer le silence. Cette attitude d’accueil réduit l’activation du stress et favorise le retour au sommeil naturel. Il ne s’agit pas de “corriger” son corps, mais de collaborer avec lui.
Nos besoins évoluent : âge, saison, hormones, émotions influencent la durée et la profondeur du sommeil. Mieux dormir, c’est d’abord cesser de se battre contre soi.
Quand on accepte son propre rythme, la nuit redevient un espace de repos, pas de performance.
La sophrologie, un retour à l’équilibre
La sophrologie s’inscrit dans cette philosophie d’écoute. Elle invite à se reconnecter à ses sensations et à son souffle.
Les exercices de respiration et de détente musculaire aident à calmer le mental pendant les réveils nocturnes.
La visualisation positive permet de retrouver la confiance : si le réveil survient, il n’est plus une menace, mais un signal de pause.
Au fil des séances, la sophrologie apprend à respecter ses cycles naturels, sans lutter. C’est une approche douce et non médicale, centrée sur l’expérience vécue. Ainsi, la nuit devient un temps de régénération intérieure, même lorsqu’elle s’interrompt un instant.
Réconcilier réveil nocturne et nature
Et si le réveil nocturne n’était pas une anomalie, mais un souvenir ancestral ?
Nos corps portent encore la mémoire des nuits partagées entre veille et sommeil (Ekirch, 2005). Pourtant, notre société veut tout contrôler : le temps, la productivité, même le repos.
Retrouver un sommeil apaisé, c’est accepter que nos nuits ne soient pas parfaites. C’est renouer avec un rythme plus humain, plus lent, plus vrai.
La sophrologie nous y ramène, pas à pas, souffle après souffle. Elle nous apprend à ne plus craindre le réveil, mais à en faire un moment de présence à soi.
Et c’est souvent là que le sommeil revient… naturellement.
Références
- Ekirch, Roger (2005). At Day’s Close – Night in Times Past. W. W. Norton & Company.
- INSERM (2023). Sommeil et rythmes circadiens.
- Dautzenberg, C. (2021). Sommeil et société, CNRS Éditions.
- Roenneberg, T. (2012). Internal Time : Chronotypes, Social Jet Lag and Why You’re So Tired. Harvard University Press.
- Harvey, A. (2020). Sleep and Anxiety, Oxford University.
Vous avez aimé cet article ?
N'en ratez plus aucun : inscrivez-vous à notre lettre mensuelle.
Tous les mois, vous recevrez un mail avec l'ensemble des articles parus durant cette période.
Pas de spam, pas de publicité : vous n'aimez pas cela, nous non plus.